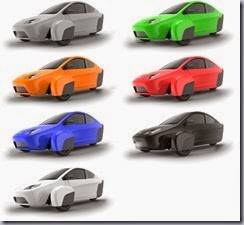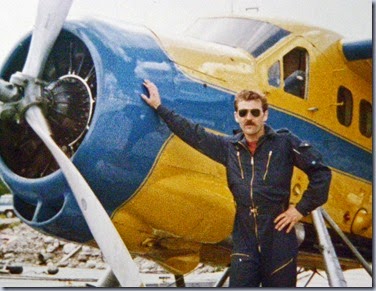Mes Îles, mon pays
Je vous avais dit que ça allait être pour une autre chronique. Voici donc que je tiens promesse. La semaine dernière, je me suis laissé emporter par un Musée que je souhaiterais encore plus représentatif de gens qui sont nés les deux pieds dans « des bottes de rubber », plantés en très jeune âge dans le sable des platiers de la « djune », le regard sur un « trou de coques », sourire heureux sur les lèvres et en arrière plan, le « tocotoc » du « botte » à Omer à Paulette qui rentre de la pêche.
Alors, cette semaine, tout comme dans le journal local, je vous fait part de mon opinion sur le possible déménagement de la pièce historique «Mes Îles Mon Pays» vers l’île centrale et peut-être dans l’aréna de Cap-aux-Meules.
Que se passe-t-il à Havre-Aubert?...(suite)
Le titre pourrait aussi être « Que se passe-t-il partout aux Îles », mais pour l’instant demeurons sur l’île de Hâvre-Aubert. Disons que le jour où l’on a annoncé le possible déménagement et la transformation de la fresque historique « Mes Îles Mon Pays » du Centre culturel de Hâvre-Aubert à l’Aréna Wendell Chiasson de Cap-aux-Meules, un certain vertige me prit par surprise. Et plus tard, quand la créatrice de ladite fresque, Mme Yolande Painchaud, s’est dite d’accord avec l’idée sur les ondes de Radio-Canada Matane, j’avoue avoir été obligé de m’assoir sur le divan le plus proche. Ensuite, après avoir écouté Mme Painchaud, j’ai cru comprendre entre les lignes de son argumentaire, cette formidable personne qui, depuis nombre d’années, porte à bout de bras une pièce théâtrale historique, qui mériterait bien mieux que le sort qu’on lui a réservé jusqu’à présent, surtout sur le plan monétaire. En résumé, une lueur d’espoir semblait s’être infiltrée dans l’avenir plutôt brumeux d’un projet qui survit année après année, mais avec peines et dettes accumulées depuis sa création.
Petit bilan émotionnel
Je suis fils de Havre-Aubert et de Havre-aux-Maisons. De Havre-Aubert, j’y ai gardé l’accent, de Havre-aux-Maisons, l’esprit combatif. À la rigolade, je me qualifie dans le rang des fiers bâtards. Tout ceci pour vous dire que mon cœur penche d’abord en ces deux lieux avant de dériver ailleurs sur toutes les autres beautés de notre archipel. Alors, vous comprendrez qu’à priori, je ne serai pas objectif dans ce qui suit. Ainsi pour avoir été participant dans une des pièces jouées au centre culturel de Havre-Aubert pendant tout un été, je ne peux me ranger à l’idée de voir cette fresque historique quitter ce village pour être transformée en imitation de « La fabuleuse » dans un aréna qui a grand besoin de rénovations sur l’île centrale de Cap-aux-Meules. L’île de Havre-Aubert, autrefois centre névralgique de toutes les Îles avec Grande-Entrée, s’est vue dépossédée de son économie tout au long de la dernière moitié du siècle dernier. Heureusement, le courage et la fierté des gens du milieu ont contribué avec l’aide du visionnaire qu’était le Père Frédéric Landry et quelques artisans comme Albert Cummings et Nicole Grégoire, à faire du site de La Grave, une réussite touristique qui fait honneur à toutes les Îles de la Madeleine. Malheureusement, le village dans son ensemble, tout comme celui de Bassin, demeurent des lieux presque à l’état comateux pendant la période hivernale, malgré toute l’énergie que déploient les résidants pour sauver l’existence de leur île. À preuve, cette belle initiative des commerçants de La Grave pendant la période de Noël et la formation du comité pour sauver le phare de l’Anse-à-la-Cabane. Hélas, il faut le constater, en hiver les maisons se vident comme autant de chalets le long des côtes de la Nouvelle-Angleterre et un esprit de résignation semble s’installer chez certains résidants, la traversée du Havre-aux-Basques vers l’île centrale étant un obstacle majeur. Comme la majeure partie des services se trouvent au centre de l’archipel et que la population vieillit de plus en plus, la question actuelle qui se pose est la suivante : « Est-ce que déplacer les activités de l’Association culturelle de Havre-Aubert vers le centre des Îles est une bonne chose pour l’île de Havre-Aubert? » — pour avoir côtoyé tout le personnel de la fresque historique Mes Îles Mon Pays pendant toute une saison et avoir été témoin du talent et de la fierté de tous ces acteurs et actrices, personnel de soutien et collaborateurs, ma réponse est NON! Bien sûr, je ne nie pas que la fresque historique a peut-être grand besoin d’un « facelift » monétaire et conceptuel important, mais de là à en détruire l’essence même pour en faire une copie ailleurs, là je ne peux m’inscrire à ce projet, si tant et si bien qu’il puisse être réalisable.
Une photo qui parle d’elle-même
Des affaissements entre les structures semblent apparents en de nombreux endroits.
Un recouvrement extérieur qui montre des signes évidents de grande faiblesse.
Il faut le reconnaître, les arénas des Îles demeurent un problème majeur quant à leur utilisation et surtout quant à leur état structurel, celui de Cap-aux-Meules ne faisant pas exception. Malheureusement, cette construction exceptionnelle est en bois et pour qui est le moindrement observateur, il aura remarqué quelques plaques correctionnelles sur la toiture et aussi, au-dessus d’une entrée latérale, un affaissement de la toiture, donc de la structure. Évidemment, les dimensions de cet édifice pourraient être idéales pour une fresque à grand déploiement, mais n’y a-t-il que la copie d’une idée issue d’ailleurs pour sauver cet aréna? Même si cette idée qui à priori demeure tout à fait digne d’analyse, l’aréna de Cap-aux-Meules risquerait de demeurer un éléphant blanc et pour diverses raisons. D’abord, tout comme bon nombre d’établissements commerciaux de ce village, le manque de places de stationnement y serait un problème majeur. Ne dit-on pas en marketing que les trois principaux atouts d’un commerce sont le stationnement, le stationnement, et puis le stationnement? Ensuite, mis à part le formidable besoin d’adaptation d’une scène digne de ce nom et l’aménagement des sièges et la mise à niveau du sol, il faudrait aussi considérer les formidables coûts de rénovation de l’édifice même. Cette structure fut en son temps une réalisation grandiose, mais les matériaux dont est faite sa structure en font un établissement de grande valeur architecturale, mais combien difficile en réparations et surtout en coûts en ces années où, notre municipalité aurait tout intérêt à diminuer ses dépenses plutôt que de les augmenter. Que faire alors de cet aréna? N’étant pas spécialiste en la matière, je ne prétendrai pas détenir la solution magique, mais je crois qu’il serait plutôt sage d’évaluer d’abord les coûts en rénovation pour sauver cet édifice avant de penser à y introduire une quelconque activité. Ce serait certes dommage que cet immeuble disparaisse avec le temps, mais il arrive parfois que même les choses auxquelles nous tenons le plus disparaissent parce que devenues trop vieilles pour être sauvées ou recyclées en d’autres choses. Les solutions ne sont pas faciles dans un tel dossier, mais je crois sincèrement que déshabiller St-Pierre pour habiller St-Paul n’est définitivement pas la solution. Déjà que les gens de l’île de Havre-Aubert doivent se battre becs et ongles, tant à Bassin qu’au bout de La Pointe à Sauvage pour sauver ce qui reste de leur village, ne faudrait-il pas penser à trouver des solutions sur place pour chacun des dossiers plutôt que de tenter d’importer d’un endroit déjà affaibli par un contexte économique difficile et une grave baisse de population, une activité qui a toute sa place dans ce village qui fut la première paroisse des Îles de la Madeleine.
Des souvenirs
En rédigeant cette chronique, je n’ai pu retenir une pensée pour tous ces merveilleux compagnons et compagnes, acteurs et actrices de Mes Îles Mon Pays, habitants de l’île du Havre-Aubert, et pour qui pendant tout l’été, ce merveilleux travail d’acteurs était devenu leur gagne-pain le plus important de l’année, ceci malgré le trop souvent manque de reconnaissance de certains organismes gouvernementaux. Travailleurs saisonniers ou acteurs, quelle est la différence puisque dans les deux cas, il s’est toujours agi d’un labeur qui devait chaque soir refléter avec grande passion la véritable condition insulaire de nos ancêtres, une condition difficile à comprendre pour qui habite un continent plutôt qu’une île.
Bonne semaine à toutes et à tous.
Georges Gaudet